Saïd Bouamama
 Devant la mosquée Al-Sedik au Caire (AFP)
Devant la mosquée Al-Sedik au Caire (AFP)
Avertissement : Le présent article devait être publié dans le numéro de mai 2025 de la revue « Les Possibles » (du Conseil scientifique d'Attac France). Il a été censuré avec l'explication suivante : « Après une semaine de réflexion et de discussion au sein de l'équipe de la revue Les Possibles, nous prenons la décision de ne pas publier ton texte. Malgré les allègements de formulation auxquels tu as consenti, il demeure une approbation de ce qui s'est déroulé le 7 octobre 2023. La revue ni l'association Attac ne peuvent faire preuve de la moindre complaisance, et encore moins, accepter de cautionner de tels massacres, ce qui à coup sûr serait très mal compris. Certes, ton texte met en évidence aussi l'effroyable génocide perpétré par le gouvernement israélien. Mais la condamnation de ce dernier ne compense pas l'acceptation du premier. Face à cette tragédie générale, croire que la stratégie du Hamas était susceptible de donner une perspective au peuple palestinien se révèle être une vue funeste puisqu'aucune solution politique n'émerge, ni même la promesse de négociations ultérieures positives. Crois bien que nous sommes meurtris de cette monstrueuse situation, et désolés de devoir prendre notre décision. Crois bien aussi que cette dernière n'entame pas notre considération et nous espérons nous retrouver en de jours meilleurs ». Sans commentaire de ma part.
Au moment de la signature du cessez-le-feu de janvier dernier, un représentant des Nations-Unies résume l'état des dégâts matériels comme suit : « L'enclave est actuellement ensevelie sous 40 à 50 millions de tonnes de décombres [...] Environ 30 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Gaza, où près de 70 % des infrastructures, 60 % des maisons et 65 % des routes ont été détruites durant la guerre de 15 mois (1). » Selon l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, le nombre de bombes larguées pendant les six premiers mois de la guerre [70 000 tonnes] dépassait déjà ceux de Londres en 1940-1941 [18300 tonnes], de Hambourg en 1943 [8500] et de Dresde en 1945 [3900 tonnes] (2) ». Ces quelques chiffres suffisent pour distinguer la séquence de guerre actuelle de l'ensemble de toutes celles qui l'ont précédée depuis 1948 et la création de l'État d'Israël. Ils soulignent l'objectif de modifier structurellement le rapport des forces dans la région, non seulement pour Tel Aviv mais également pour Washington.
L'évolution rapide du contexte régional dans l'avant 7 octobre
Le contexte régional est en évolution particulièrement rapide avant le 7 octobre 2023. La séquence initiale de la période est une tendance offensive de longue durée des Etats-Unis et d'Israël, enclenchée avec les accords d'Oslo visant à isoler entièrement la résistance palestinienne par le biais des « accords d'Abraham ». Chacun des acteurs de ces accords poursuit ses propres objectifs en les acceptant dans une logique de realpolitik froide et cynique. Hicham Alaoui, chercheur à Berkeley, analysait dans un texte antérieur au 7 octobre ces accords comme étant une alliance entre trois fondamentalismes, celui des évangélistes états-uniens, des fondamentalistes juifs en Israël et des « fondamentalistes étatiques » dans les pays arabes signataires des accords. Il résumait comme suit les objectifs de chacun d'entre eux avant le cataclysme du 7 octobre :
« Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, voulaient relancer une hégémonie déclinante [...] Les alliés (les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc) faisaient miroiter les perspectives d'une normalisation avec Israël pour obtenir de nouveaux accords commerciaux, une assistance militaire et d'autres avantages. Le Maroc [...] espérait qu'une main tendue vers Tel-Aviv allègerait les pressions exercées sur lui au sujet du Sahara occidental, avec à la clé une reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur ce territoire (1).»

La dimension religieuse de l'accord n'est, selon nous, que l'enveloppe apparente, des intérêts économiques et géostratégiques en jeu dans la région. Les classes dominantes poursuivent toujours leurs intérêts en utilisant les moyens jugés les plus efficaces dans un contexte donné. Pour Washington, l'enjeu est, bien sûr, le contrôle du nœud stratégique mondial qu'est le Moyen-Orient. A l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, cette région occupe cette place de nœud depuis plusieurs siècles et a été une préoccupation centrale de toutes les puissances coloniales puis impérialistes depuis la naissance du capitalisme en Europe (2). C'est cette dimension de nœud stratégique qui est la base matérielle du soutien occidental inconditionnel à Israël qu'illustre une nouvelle fois le génocide actuel. C'est également elle qui dicte les axes centraux de la stratégie états-unienne : contrecarrer la dynamique économique des BRICS et en particulier de la Chine, isoler l'Iran avant de pouvoir l'abattre, imposer Israël comme puissance régionale dominante et comme gérant local des intérêts occidentaux.
Pour mener à bien ces buts stratégiques, l'isolement de l'Iran était un impératif. Il en a découlé l'exacerbation volontaire du pseudo antagonisme shiite-sunnite. La grille de lecture religieuse, volontairement promue par Washington, permet de masquer les enjeux matériels et stratégiques réels qui sont mondiaux, en les évoquant comme étant de dimension uniquement régionale. Ils ne seraient, selon le discours dominant, politiquement et médiatiquement que le résultat d'un « impérialisme iranien » auquel résistent les États sunnites. Cette grille réductrice de lecture a justifié à partir de 2015, l'intervention militaire au Yémen de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis et le soutien des États-Unis.
Cette séquence initiale prend fin au cours de l'année 2023 qui voit le monde connaître une brusque accélération. Plusieurs facteurs se sont cumulés à partir de 2021 pour produire cette accélération sous le regard momentanément impuissant de Washington. Le premier d'entre eux est la percée économique chinoise dans la région et ses traductions diplomatiques. Le Golfe assure désormais 40 % des besoins chinois de pétrole. La sécurisation de cet approvisionnement se traduit par une activité diplomatique intense avec d'une part la signature en mars 2021 d'un accord de coopération stratégique d'une valeur de 450 milliards de dollars états-uniens et d'autre part l'organisation en décembre 2022 de trois sommets en Arabie Saoudite lors de la visite du président chinois dans ce pays : un sommet Chine-pays du Golfe, un autre Chine-Pays Arabes et enfin un sommet Chine-Arabie Saoudite.

Le second facteur est l'impasse militaire au Yémen. Cette guerre a couté plus de 100 milliards de dollars au royaume saoudien sans atteindre aucun des buts de guerre (3). Le troisième facteur est le « coût moral » de cette guerre considérée par les Nations-Unies comme la pire catastrophe humanitaire au monde (4). Le cumul de ces facteurs a conduit au cataclysme pour les États-Unis qu'a été le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en mars 2023 à la suite de négociations secrètes qui se sont déroulées sous médiation chinoise. L'allié historique des États-Unis renoue les liens diplomatiques avec « l'ennemi shiite » que Washington a mis tant d'effort à construire, de surcroît sous médiation de la Chine, considéré comme « l'ennemi numéro un » depuis l'adoption par les États-Unis de la théorie du « pivot asiatique » au tournant de la décennie 2010. Une nouvelle fois était vérifié l'adage attribué à De Gaulle : « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ».
La signification stratégique du 7 octobre
Le contexte récent d'accélération brusque de l'histoire est incontournable pour comprendre à la fois l'offensive militaire palestinienne du 7 octobre et ses objectifs, la violence de la réaction israélienne encouragée par Washington et le rapport des forces actuel après 18 mois de génocide. C'est en effet cette mutation du contexte régional qui a conduit les organisations de résistance palestinienne à considérer, à juste titre, que la situation était propice à briser la dynamique des accords d'Abraham. Ceux-ci avaient en effet imposé un isolement de la résistance palestinienne, une colonisation accrue, la transformation de Gaza en prison à ciel ouvert pour ses deux millions d'habitants et la disparition de la question palestinienne de l'agenda politique et diplomatique mondial. L'objectif premier et le résultat du 7 octobre est bien le gel momentané de la dynamique des accords d'Abraham et le retour de la question palestinienne qui s'impose de nouveau en haut des agendas.
Cet objectif est partagé par l'ensemble des organisations de la résistance palestinienne. L'opération « déluge Al-Aqsa » du 7 octobre n'est pas seulement celle du « Hamas » comme l'ont affirmé et l'affirment encore la plupart des médias. Cinq autres organisations participèrent à cette opération militaire allant du Djihad Islamique au Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) qui se réclame du marxisme. Même si le Hamas a une importance prépondérante, nous sommes loin de la réduction dominante à une action menée par des fanatiques islamistes.
Pour parvenir à un tel résultat une opération militaire d'envergure était nécessaire. L'attaque simultanée des bases militaires israélienne du pourtour de la bande de Gaza et des villes proches de celles-ci par des commandos franchissant le mur de séparation à pied, à moto, en voiture, en camion ou en ULM, regroupe près de 3000 combattants. L'objectif de l'opération est de faire le maximum d'otages pour négocier ensuite la libération de prisonniers palestiniens. S'appuyant sur l'estimation de la sécurité sociale israélienne, la dépêche AFP du 15 décembre 2023 évalue comme suit le nombre de victimes : « Le nombre de morts de l'attaque est aujourd'hui de 695 civils israéliens, dont 36 enfants, ainsi que 373 forces de sécurité et 71 étrangers, ce qui donne un total de 1 139 hommes (5). » Le nombre d'otage est estimé par les autorités israélienne à 240. Ces quelques chiffres suffisent à souligner l'ampleur inédite de l'opération. Ils mettent aussi en exergue la disproportion de la riposte israélienne. L'UNICEF présente comme suit le bilan humain de cette riposte au 24 avril : 51 266 tués dont 15 613 enfants et 11200 disparus (6).
Un an après le 7 octobre 2024, l'historien Vincent Lemire analyse comme suit ce qu'il appelle un « tournant radical » : « Le 7 octobre est un tournant radical. Ce conflit a connu une succession de guerres interétatiques (1948, 1967 et 1973), d'intifadas (1987 et 2000), puis l'échec des accords d'Oslo (1993) et, enfin, les accords d'Abraham (2020). Le 7 octobre a mis fin au mirage des accords de paix du passé, et à cette illusion de croire que des accords commerciaux entre Israël et des régimes autoritaires arabes pourraient régler la question palestinienne (7). »
Le 7 octobre a eu aussi pour résultat de faire voler en éclat le roman sécuritaire israélien posant une invulnérabilité totale de l'État israélien en raison de sa supériorité technologique militaire et de services de renseignements affichés comme infaillibles. Ce roman sécuritaire a été consciemment et durablement diffusé pour produire un sentiment de sécurité quasi-total au sein de la population israélienne. En janvier dernier, la correspondante du Monde à Tel-Aviv titrait son article, « En Israël, une émigration sans précédent » en expliquant : « Des milliers d'Israéliens, parfois des familles entières, ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger. En cause, l'insécurité et la guerre à Gaza, mais aussi la politique du gouvernement Nétanyahou et le poids de la religion dans le pays (8). » Le bureau central des statistiques israélien évalue en décembre 2024 ces départs comme suit pour l'année 2023 : « 82 700 personnes ont quitté Israël en 2024, tandis que 23 800 seulement y sont revenues (9). » Du jamais vu depuis la création de l'État d'Israël. La situation est similaire à la frontière libanaise où le sentiment d'insécurité n'a jamais été aussi important. L'idée d'une politique de dissuasion efficace par la menace permanente d'une intervention au Liban n'est plus crédible pour un nombre grandissant d'Israéliens.

De même, le discours officiel israélien sur la résistance palestinienne est largement fragilisé. Celui-ci affirmait une perte de puissance de cette résistance qui ne tenait plus que par le soutien extérieur, et en particulier celui de l'Iran. Depuis plusieurs décennies, l'axe central de la défense officiellement énoncé était la fameuse « menace iranienne », les territoires palestiniens étant considérés au mieux comme entièrement maitrisés et au pire comme maitrisables rapidement. L'opération « déluge Al-Aqsa » dément l'image d'une résistance palestinienne réduite à quelques groupuscules. Elle atteste de la capacité de cette résistance à mener des attaques de grande envergure. Enfin l'ampleur du soutien états-unien est venue souligner aux yeux de tous, l'impossible « sécurité » sans une dépendance extrême à une puissance extérieure. Certes les États-Unis n'ont jamais ménagé dans le passé l'aide économique et militaire à Tel-Aviv mais jamais dans les proportions actuelles : déploiement de navires de guerre, livraison massive d'armes, soutiens logistiques, etc.
Ces quelques facteurs indiquent que le 7 octobre a produit une modification brusque et radicale du rapport de force régional en faveur des Palestiniens. La violence de la réponse israélienne, c'est-à-dire le génocide ignoble perpétré depuis une année et demie, est incompréhensible sans la prise en compte de ce changement inattendu. Loin de n'être que le résultat d'une simple « folie » d'un Netanyahou, elle est d'abord une tentative d'inverser tout aussi radicalement le nouveau rapport de force produit par le 7 octobre.
Buts de guerre affichés et buts de guerre réels
Le génocide en cours s'est déployé à partir de trois buts de guerre affichés dès le début du carnage : « éradiquer le Hamas, libérer les otages et empêcher Gaza de demeurer une menace pour la sécurité d'Israël. » Quatre mois plus tard, il revient à la charge pour rappeler ces buts et promettre que « La victoire est à portée de main. Cela ne se compte pas en années ou en décennies, c'est une affaire de mois (10). » Outre le caractère contradictoire du but de la « libération des otages » et de celui « d'éradiquer le Hamas », ces buts de guerre sont impossibles à atteindre. Comme souvent dans les guerres coloniales, les militaires sont plus lucides à l'image du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari qui déclare à la télévision le 19 juin 2024 : « Le Hamas est une idéologie, on n'élimine pas une idéologie. Dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public (11). »
L'élargissement officiel des buts de guerre le 17 septembre 2024 est tout autant irréaliste. Le communiqué de ce jour annonce comme suit cet élargissement : « le retour en toute sécurité des habitants du nord (du pays) dans leurs maisons (12). » Le nouveau but de guerre est précisé la même semaine sur le plan des moyens : « détruire toute la structure militaire du Hezbollah, qui s'est construite sur deux décennies (13). » Le chercheur et expert militaire au Centre français de recherche sur le renseignement, Olivier Dujardin, évalue comme suit le réalisme d'un tel but : « On ne détruit pas une organisation comme le Hezbollah. Même l'élimination de tous ses membres n'engendrerait pas sa disparition parce que la raison et les conditions qui président à son existence sont toujours d'actualité. Lorsque vous affrontez une organisation comme le Hezbollah, qui peut compter 50 000 ou 100 000 combattants selon les sources, et que vous décapitez des têtes, subitement vous avez affaire à une myriade de cellules qui vont mettre un certain temps à se réunifier, mais cela se produira en fin de compte [...]. Les Israéliens achètent du temps pour quelques semaines ou quelques mois uniquement (14). »
Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne signifient pas une irrationalité du premier ministre israélien. La réduction courante de Netanyahou à un dément entièrement déconnecté de la réalité n'aide en rien à comprendre la situation. Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne sont, à notre sens, que des paravents visant à masquer ses véritables buts de guerre : redessiner l'ensemble de la carte régionale. Ce but central de guerre partagé depuis longtemps avec les néoconservateurs états-uniens suppose un redécoupage des frontières avec la Syrie et le Liban, une mise en dépendance totale de la Jordanie et de l'Égypte, une mise au pas de l'Iran, une déportation massive des Palestiniens et une suprématie régionale reconnue contractuellement à Israël.
Éléments de bilan d'une guerre génocidaire
Un an et demi après le début d'une guerre génocidaire annoncée comme ne devant durer que « quelques mois », aucun des buts de guerre n'est atteint. Non seulement le Hamas et le Hezbollah n'ont pas été éradiqués mais Tel-Aviv a été contraint de négocier des cessez-le-feu avec eux. Cet échec stratégique ne doit cependant pas conduire à sous-estimer l'ampleur des victoires tactiques obtenues par un déploiement inédit des forces militaires dans la région, des dépenses militaires tout autant sans précédent et une violence génocidaire durable sans limite. Les coups portés tant aux forces de la résistance palestinienne et à la principale d'entre elles, le Hamas, sont sérieux. Ils affaiblissent considérablement et durablement les capacités d'action militaire de ces forces. Il en est de même au Liban avec le Hezbollah.
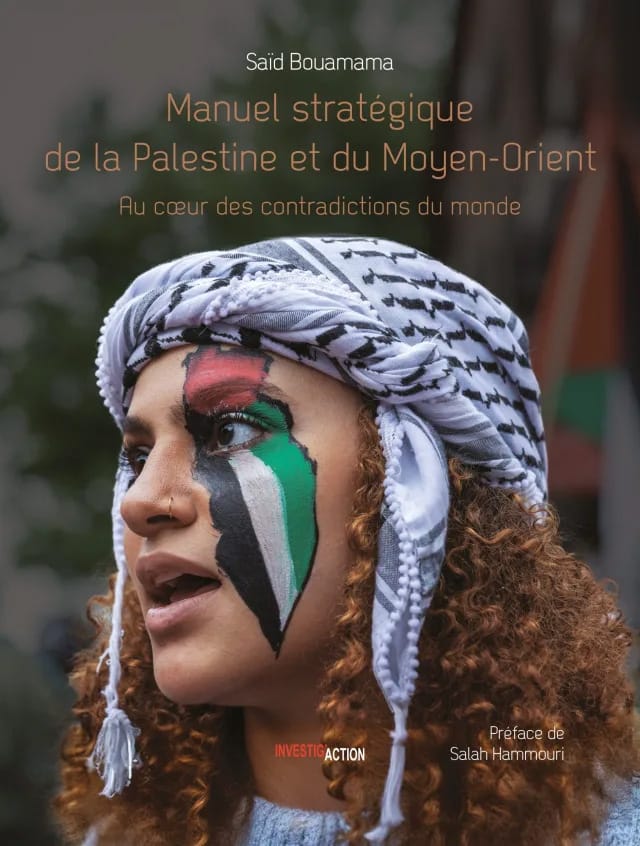
Depuis le 7 octobre, Netanyahou a réaffirmé Israël comme première puissance militaire régionale. Cette démonstration de force, entièrement disproportionnée au regard des forces adverses, est incompréhensible sans la prise en compte de l'ampleur des effets du 7 octobre sur la société israélienne, sur le peuple palestinien et plus largement sur l'ensemble des peuples de la région. Il s'agissait de tenter de rétablir le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, même au prix d'un génocide. L'image internationale d'Israël, la vie des otages, les équilibres internes à la société politique israélienne, etc., tout a été sacrifié à cette préoccupation première de court terme. Le prix à payer est lourd. Israël n'a jamais été aussi discrédité aux yeux de l'opinion publique mondiale. La plainte pour génocide devant la Cour Internationale de Justice déposée par la République Sud-africaine a été rapidement soutenue par quinze pays. Les pays reconnaissant un Etat palestinien se multiplient à l'image de l'Espagne, de l'Irlande, de la Norvège, de la Slovénie ou de l'Arménie. Le Tribunal Pénal International émet un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense en novembre 2024 suite à son enquête pour crime de guerre. Ces faits soulignent que la victoire militaire se réalise au prix d'une défaite morale massive qui, elle, est de long terme.
La victoire militaire tactique d'Israël ne s'accompagne d'aucune victoire politique. Aucune distance ne s'est installée entre le peuple palestinien et ses organisations de résistance, ni entre le Hezbollah et les habitants du Sud-Liban. Une des fonctions de la violence totale de l'armée israélienne était justement de produire une telle fracture. L'image des retours de réfugiés au moment des cessez-le-feu tant à Gaza qu'au Liban atteste d'un échec complet dans ce domaine. C'est en brandissant des drapeaux du Hamas et du Hezbollah que les réfugiés rentrent chez eux se réinstaller dans des ruines. Or toute l'histoire des luttes de libération nationale atteste que les victoires militaires sans victoire politique peuvent certes affaiblir l'adversaire, mais ne peuvent pas le vaincre et encore moins l'éradiquer comme le clame Netanyahou.
Après, par exemple, les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie en 1945 qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts, le général Duval en charge de ce crime résumait comme suit la situation : «Je vous ai donné la paix pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable (15). » L'adolescent Kateb Yacine témoin de cette violence, explique, lui, les effets sur sa trajectoire de ce spectacle macabre : « C'est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme (16). » Les enfants et adolescents qui constituent désormais la « génération du génocide » connaîtront logiquement des effets similaires. En janvier 2025, le secrétaire d'État états-unien Anthony Blinken le constate déjà: « Sans [...] un horizon politique crédible pour les Palestiniens, le Hamas - ou quelque chose d'autre aussi abject et dangereux - repoussera [...], nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu'il en a perdus (17). » La situation est, bien entendu, similaire au Liban pour le Hezbollah.
Le tournant de 2025
La chute de Bachar Al-Assad puis l'arrivée de Trump au pouvoir sont deux évènements qui modifient considérablement le rapport des forces. La nouvelle configuration supprime une base arrière des résistances palestinienne et libanaise, isole encore plus l'Iran et supprime toutes les limites, même formelles, aux plans de chirurgie politique et territoriale de Netanyahou. S'estimant, à juste titre, dans une situation historique inédite depuis la Nakba, il pense pouvoir désormais assumer ses buts réels de guerre. Il ne s'agit plus d' « éradiquer le Hamas » mais de transformer Gaza et la Cisjordanie en espaces invivables afin de susciter un exode massif. L'objectif n'est plus d'installer une administration palestinienne entièrement dépendante de Tel-Aviv mais d'accélérer considérablement la colonisation. Le but n'est plus de sécuriser les frontières sud du Liban mais d'imposer un désarmement du Hezbollah pour le moins et une transformation des frontières pour le mieux. La même logique prévaut en Syrie où l'objectif d'une présence durable est affirmé au prétexte de la mise en place d'une « zone de sécurité ».
Le discours de Donald Trump sur « Gaza-Riviera » le 4 février n'est pas un simple délire de mégalomane. Il vise à choquer par son maximalisme afin de rendre acceptable des « solutions » intermédiaires tout aussi inacceptables. Il permet de banaliser l'idée de déportation massive en orientant le débat sur les conditions de celle-ci. Les violations des cessez-le-feu en Palestine comme au Liban et l'installation durable de troupes israéliennes en Syrie inaugurent une nouvelle stratégie militaire pour les atteindre. Sans être exhaustif, abordons quelques-uns de ces axes stratégiques.

Le premier est une pression politique et diplomatique du gouvernement états-uniens sur le Liban, associée à la poursuite de bombardements israéliens pour obtenir un désarmement du Hezbollah. Compte-tenu de l'état de l'armée libanaise, un tel désarmement signifierait un Liban sans aucune capacité de défense. Le second axe est la destruction de l'ensemble des capacités militaires syriennes, malgré un nouveau gouvernement pour le moins conciliant avec Tel-Aviv. Dans la foulée, l'argument sécuritaire est mis en avant pour justifier une zone de sécurité durable. Le troisième axe est, bien entendu, l'Iran sur qui il s'agit d'exercer une pression forte pour que Téhéran se replie dans une posture uniquement défensive et d'arrêt du soutien aux résistances libanaise et palestinienne.
Concernant la Palestine, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, le changement militaire inauguré avec la reprise de la guerre, le 18 mars, prend la forme du discours sur les « zones tampons » qui ne sont rien d'autre qu'une annexion. Les bombardements et assassinats de personnalités de la résistance, qui étaient les formes principales de l'intervention militaire depuis le 8 octobre, cèdent le pas à l'occupation pure et simple. Simultanément est poursuivie la destruction méthodique de toutes les conditions d'existence, et en particulier des infrastructures [scolaires, médicales, religieuses, etc.] dans les zones non annexées. La visée est, bien entendu, d'installer un sentiment d'impuissance, de diffuser un désarmement moral, de produire une logique de renoncement, de fabriquer un consentement à l'exil. Loin d'être aveugles, les opérations militaires israéliennes sont au contraire assises sur ces visées de démoralisation collective.
Au moment où nous terminons cet article, aucun signe de réussite de la nouvelle stratégie n'est repérable en dépit d'une vie quotidienne devenue cauchemardesque en Palestine. La prudence même avec laquelle l'armée israélienne évite tout contact militaire direct avec les villes palestiniennes indique que le Hamas est loin d'être « éradiqué ». La révolte massive espérée des Palestiniens contre les organisations de la résistance n'a pas eu lieu. Les rêves d'un accord avec les pays voisins pour qu'ils accueillent les Palestiniens sont enterrés, les gouvernements de ces pays ne pouvant pas assumer devant leur peuple la complicité avec une telle déportation. Au Liban, le Hezbollah, qui est fortement affaibli mais qui demeure la principale force militaire du pays, a rejeté totalement l'idée même d'un désarmement. Les tentatives états-uniennes d'obtenir de l'Arabie Saoudite et des Émirats une reprise de la guerre contre les Houtis ont reçu une fin de non-recevoir pour les mêmes raisons. En Iran, malgré les menaces et ultimatums de Trump, celui-ci ouvre des négociations avec Téhéran, ruinant les rêves de Netanyahou d'une guerre rapide et totale. Même le nouveau régime syrien est obligé de reculer officiellement sur ses annonces d'une signature d'accords d'Abraham avec Tel-Aviv en 2026, tant a été forte la réaction populaire.
Le panorama actuel est loin d'être celui d'une réussite stratégique israélienne. Il fait plus penser à une logique du bourbier et de l'enlisement.
(1) Hicham Alaoui, Les accords d'Abraham, expression d'une alliance religieuse fondamentaliste, Orient XXI du 12 octobre 2023 [l'auteur précise que son analyse a été écrite avant le 7 octobre].
(2) Seule une autre région, l'Asie du Sud-Est revêt également cette dimension de nœud stratégique mondial avec sa part de 40 % du commerce transocéanique mondial. Elle est sans surprise également un lieu d'affrontement permanent, en particulier sino-états-unien.
(3). « Under Pressure : Houthis Target Yemeni Government with Economic Warfare », Middle East Institute, 27/02/2023
(4) « Yémen: pire catastrophe humanitaire au monde, la sortie de crise exige un dialogue politique entre les parties, selon de hauts responsables onusiens »,
(5) Dépêche AFP du 15-12-2023.
(6) Unicef, Israël-Territoires palestiniens : après le cessez-le-feu, l'incertitude, consultable sur le site de l'UNICEF, unicef.fr
(7) Vincent Lemire, Le 7 octobre est un tournant radical, La Chronique, magazine d'Amnesty International du 7-10-2024.
(8) Isabelle Mandraud, En Israël, une émigration sans précédent, Le Monde du 28 janvier 2025.
(9). « En Israël, une "fuite des cerveaux" massive en 2024 », Courrier International du 2 janvier 2025.
(10) Conférence de presse de Benjamin Netanyahou, Dépêche AFP du 7 février 2024.
(11) Dépêche AFP du 19 juin 2024.
(12) « «Le retour des habitants du nord d'Israël, nouveau but de guerre pour Netanyahou », Communiqué du bureau du premier ministre, AFP du 17 septembre.
(13) Ghazal Golshiri et Hélène Sallon, L'embarras de l'Iran face à l'offensive israélienne contre le Hezbollah, Le Monde du 25 septembre 2024.
(14) « Israël rêve d'un « nouveau Moyen-Orient », mais à quelle réalité se heurtera-t-il ? », The Conversation du 29 octobre 2024.
(15) Lettre du général Duval au gouvernement français du 16 mai 1945, cité dans Guy Pervillé, La guerre d'Algérie, PUF, Paris, 2021, p. 34.
(16) Boucif Mekhaled, Entretien avec Kateb Yacine du 21 juillet 1984, dans Chronique d'un massacre, 8 mai 1945, Paris, Édition Syros, 1995.
(17) Le Monde du 14 janvier 2025.
Source : Le blog de Saïd Bouamama